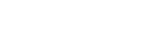Retrouvez chaque mois l'éditorial du Délégué général de la FCA dans Repères Flash, la revue mensuelle de la FCA réservée à ses adhérents.
Si évoquer les coopératives dispose la plupart d’entre nous à des sentiments plutôt favorables à leur endroit,
y reste encore trop souvent associée une connotation désuète. C’est que dans l’imaginaire collectif contemporain, on leur accole encore trop souvent l’image de structures modestes et sans doute finalement peu efficientes. Et pourtant, qui sait qu’aux États-Unis, terre du capitalisme financier le plus aguerri, évolue avec succès le premier écosystème
au monde mobilisé très tôt par l’État fédéral pour traverser les crises les plus profondes ?
En effet, il y a un siècle, ce qui est devenu la première puissance économique mondiale et le premier pays pour la production et la consommation d’électricité, se retrouve confrontée à l’hyperconcentration des entreprises électriques privées entre les mains de holding qui réduisent les investissements tout en maximisant la génération de liquidités destinées sous la forme de dividendes aux grands actionnaires. Face à une position monopolistique dangereuse, aux abus et aux détournements, ainsi qu’aux nombreuses faillites provoquées par le krach boursier de 1929, sont mises en place des restrictions très sévères conduisant en retour à une rapide et drastique diminution du nombre de ces structures.
C’est alors qu’en réponse au défaut d’investissement des pouvoirs publics et des groupes privés naissent des initiatives citoyennes locales à travers la constitution de coopératives, aujourd’hui au nombre de 900, spécialisées dans la production, transmission et distribution d’électricité. Avec plus de 42 % des lignes électriques, elles couvrent les trois quarts du pays et desservent 40 millions de personnes, soit 12 % de la population. Plus de 90 % d’entre elles incluent dans leur portefeuille la production d’énergie renouvelable faisant la preuve de leurs fortes capacités d’innovation.
Cette logique trouve son propre exemple en France dans le secteur de la santé soumis à une financiarisation galopante et, partant, à l’empire tyrannique et exclusif du meilleur seuil de rentabilité. Or la recherche légitime de profit ne peut être l’unique priorité d’un acteur de santé, pharmacien, biologiste ou radiologue, qui forme le voeu d’exercer là où il vit, au service du bien commun. Les coopératives permettent de concilier la légitime recherche de performance économique avec l’exercice vocationnel de professionnels de santé restés libres, indépendants et maîtres de leur attache locale. Sans quoi, ce sont des centaines de territoires qui, faute d’être suffisamment attrayants financièrement, seront tout bonnement délaissés. Cette différence d’approche n’est pas simplement d’ordre philosophique et morale, elle est d’abord ontologique.
Alors devant l’avancée des déserts territoriaux, il est à espérer que les réseaux coopératifs continuent d’être les remparts de ces oasis où l’on se retrouve pour faire nation.
* André Gide